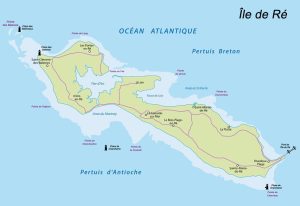La rose trémière (Alcea rosea) est une haute fleur ornementale qui orne les ruelles et les jardins de l’Île de Ré dès le début de l’été. Sur cette île de Charente-Maritime, le climat océanique doux et les sols sablonneux offrent des conditions favorables à cette plante rustique, originaire d’Asie. Introduite en Europe au Moyen Âge – probablement rapportée d’Orient par les croisés – la rose trémière s’est particulièrement bien acclimatée sur l’Île de Ré.
Au sommaire :
Selon les récits, les marins revenant de voyages l’auraient implantée sur l’île dès le XVIe siècle. Aujourd’hui, ses longues tiges dressées, couvertes de fleurs aux couleurs variées, font partie du paysage des villages rétais où elles poussent spontanément au pied des murs blanchis à la chaux. Appréciée des habitants, la rose trémière est même considérée comme un symbole floral local. Par le passé, ses pétales contiennent des pigments violets qui servaient à teindre des tissus, ce qui témoigne de son utilité au-delà de son rôle décoratif.
Caractéristiques botaniques de la rose trémière
La rose trémière appartient à la famille botanique des Malvacées, la même famille que la mauve et l’hibiscus. Il s’agit le plus souvent d’une plante bisannuelle (cycle de deux ans), bien qu’elle puisse parfois se comporter en vivace de courte durée.
Sa croissance est rapide et sa taille impressionnante : elle peut atteindre entre 1,5 et 3 mètres de hauteur à maturité. Ses feuilles vertes sont larges, arrondies et découpées en lobes, rappelant celles de la mauve.
La floraison a lieu de la fin du printemps jusqu’à la fin de l’été, produisant de grandes fleurs en forme de coupe le long de la tige. Les coloris vont du blanc au pourpre foncé en passant par le jaune, le rose ou le rouge. Il existe même une variété ancienne dite « Nigra » dont les fleurs présentent une teinte pourpre presque noire. Chaque fleur de base est « simple » avec cinq pétales, mais de nombreuses variétés horticoles offrent des formes à fleurs doubles très fournies en pétales.
| Nom scientifique | Alcea rosea |
| Famille botanique | Malvacées (Malvaceae) |
| Origine géographique | Asie de l’Est (introduite en Europe au XIIe–XVIe siècle) |
| Type de plante | Bisannuelle ou vivace éphémère |
| Hauteur adulte | 1,5 à 3 mètres environ |
| Période de floraison | Fin du printemps à fin d’été (juin à septembre) |
| Couleurs de fleurs | Blanc, jaune, rose, rouge, violet, pourpre presque noir (selon variétés) |
| Exposition recommandée | Soleil ou mi-ombre, emplacement abrité du vent |
| Sol préféré | Léger, bien drainé (sableux), tolère la sécheresse une fois établi |
Semis et plantation de la rose trémière
La rose trémière se ressème facilement toute seule si on laisse ses graines se disperser. Cependant, pour maîtriser son emplacement ou introduire de nouvelles couleurs, le jardinier peut semer les graines manuellement à différentes périodes de l’année. Les semis réussissent d’autant mieux que la plante a une racine pivotante profonde qu’il vaut mieux ne pas déranger : il est donc recommandé d’effectuer le semis directement en place quand c’est possible. On distingue trois périodes propices pour semer :
- Fin d’hiver (février) – Semis sous abri (en terrine, à l’intérieur). Grâce à cette méthode, on peut obtenir quelques fleurs dès l’été de la même année.
- Printemps (mars à mai) – Semis directement en pleine terre au jardin. Les plantes ainsi obtenues fleuriront l’été de l’année suivante.
- Début d’été (juillet) – Semis juste après la floraison, soit en place au jardin, soit en godets. Les jeunes plants sont alors conservés sous châssis froid pendant l’hiver, mis en terre au printemps suivant, et fleuriront l’été d’après.
Quel que soit le mode de semis, il convient d’arroser régulièrement jusqu’à la germination (qui prend environ 2 à 3 semaines) et de garder le sol humide pendant cette période. Il est difficile de repiquer les plantules issues de semis spontanés à cause de leur longue racine : mieux vaut semer directement à l’endroit désiré pour éviter de devoir les transplanter.
Si l’on ne souhaite pas faire de semis, on peut aussi planter de jeunes plants achetés en godet : la mise en terre de ces plants s’effectue soit au printemps (avril–mai après les dernières gelées), soit en début d’automne (septembre–octobre) dans les régions au climat hivernal doux. Dans tous les cas, il est conseillé de laisser au moins 30 cm entre deux pieds de rose trémière afin qu’ils aient suffisamment d’espace pour se développer. Sur les sites ventés, un tuteur peut être installé pour soutenir la tige florale et éviter qu’elle ne casse en pleine floraison.
Récolte et conservation des graines
Après la floraison, la rose trémière forme des fruits ronds appelés capsules, disposés en couronne à la base des fleurs fanées. Chaque capsule contient une quinzaine de graines dures, de forme circulaire et aplatie. Pour récolter des graines de rose trémière, il faut attendre que ces capsules sèchent sur la tige et commencent à s’ouvrir. On peut alors les détacher délicatement et extraire les graines. Il est recommandé de laisser ensuite les graines récoltées finir de sécher à l’air libre pendant quelques jours.
Une fois bien sèches, les graines sont à conserver dans un contenant hermétique ou un sachet en papier, placé au sec et à l’abri de la lumière. Stockées dans de bonnes conditions, elles gardent leur pouvoir germinatif pendant environ 2 à 3 ans. Cependant, plus la graine est fraîche, meilleure est la germination : souvent, les semences de l’année germent plus facilement que des graines anciennes. On peut choisir de semer les graines récoltées dès la fin de l’été ou au printemps suivant. À noter que si les graines tombent naturellement au sol à l’automne, beaucoup passeront l’hiver dehors et germeront spontanément au printemps, assurant ainsi la relève des fleurs pour la saison suivante.
La rose trémière est-elle comestible ?
Comme beaucoup de plantes de la famille des Malvacées, la rose trémière est une plante comestible dans toutes ses parties. Bien que son usage alimentaire soit aujourd’hui méconnu, elle était autrefois appréciée pour ses vertus nourrissantes et médicinales. Les jeunes feuilles tendres peuvent être consommées crues, finement hachées en salade, ou cuites à la manière des épinards.
Elles ont une texture légèrement mucilagineuse en bouche. Les fleurs, de leur côté, sont également comestibles : on peut par exemple parsemer des pétales frais dans une salade pour apporter une touche de couleur. Séchés, ces pétales servent aussi à préparer des infusions aux propriétés adoucissantes. Leur goût est doux, rappelant celui de la mauve.
Sur le plan médicinal, la rose trémière possède des propriétés similaires à celles de la guimauve officinale. Grâce à sa teneur élevée en mucilages (substances végétales adoucissantes), elle a longtemps été utilisée pour calmer les irritations de la gorge et la toux. Sans être une plante médicinale majeure de nos jours, elle entre encore dans la composition de certaines tisanes apaisantes.
Par ailleurs, la racine de rose trémière contient de l’amidon et a pu servir, tout comme la guimauve, à préparer des remèdes traditionnels. L’ensemble de ces usages, alimentaires ou thérapeutiques, reste toutefois marginal et la rose trémière est avant tout cultivée de nos jours pour l’ornement du jardin.
Variétés à fleurs simples et à fleurs doubles
Dans sa forme « sauvage » ou traditionnelle, la rose trémière porte des fleurs simples composées de cinq larges pétales. Ces corolles simples, légèrement en forme d’entonnoir, laissent facilement apparaître le cœur de la fleur et ses étamines proéminentes. À côté de cela, l’horticulture a développé de nombreuses variétés à fleurs doubles, reconnaissables à leurs multiples pétales qui donnent à la fleur un aspect de pompon volumineux. Les roses trémières doubles offrent un effet très décoratif au jardin, évoquant par leur opulence des fleurs comme la pivoine ou l’œillet. Elles se déclinent dans les mêmes coloris que les variétés simples et permettent de créer des massifs très fleuris au style un peu rétro.
Ces formes doubles présentent néanmoins quelques particularités. D’une part, les fleurs très doubles produisent souvent moins de pollen et de nectar accessibles, ce qui les rend un peu moins attractives pour les insectes pollinisateurs comparées aux formes simples. D’autre part, les variétés doubles tendent à fournir moins de graines viables à la fin de la saison. En pratique, la multiplication spontanée est donc plus rare avec ces cultivars très élaborés, et le jardinier renouvelle généralement ses plants en rachetant des graines ou des jeunes plants de roses trémières doubles lorsque cela devient nécessaire. Mis à part ces différences, l’entretien de ces variétés ne diffère pas de celui des roses trémières classiques.
Faut-il couper les roses trémières ?
La question de la taille de la rose trémière se pose souvent une fois que l’été se termine. Faut-il couper la grande tige florale après la floraison ? En réalité, cette plante ne demande pas de taille stricte pour refleurir, car la majorité des roses trémières cultivées sont bisannuelles et ne refleuriront pas une fois leur cycle accompli. En fin d’été, la hampe florale se dessèche progressivement en libérant ses graines. Si l’on souhaite favoriser le semis naturel, il est conseillé de ne pas la couper trop tôt : mieux vaut attendre que les graines soient tombées ou récoltées avant d’éliminer la tige sèche.
En revanche, pour des raisons esthétiques et sanitaires, on peut tout à fait couper les tiges fanées à l’automne. La coupe à la base des tiges sèches a l’avantage de nettoyer les massifs et d’éviter la dispersion non contrôlée des graines un peu partout au jardin. Surtout, cela limite la survie de maladies sur les débris de plantes : par exemple, le champignon de la rouille peut hiverner sur les tiges et feuilles mortes restées au sol.
En supprimant ces parties atteintes et en les éliminant (de préférence hors du compost), on réduit le risque de voir réapparaître la maladie l’année suivante. À noter que pendant la saison de floraison, on peut aussi retirer régulièrement les feuilles basses abîmées ou jaunies (notamment si elles sont atteintes de rouille) afin d’améliorer l’esthétique de la plante et de freiner le développement de la maladie.
Maladies et parasites des roses trémières
La rose trémière est une plante robuste et adaptée aux climats secs, mais elle peut être sensible à quelques maladies et nuisibles spécifiques. Le principal problème sanitaire rencontré avec cette fleur est la rouille, une maladie cryptogamique très courante sur les feuilles de roses trémières. D’autres champignons ainsi que certains insectes peuvent également causer des dommages :
- Rouille (Puccinia malvacearum) – C’est la maladie la plus fréquente des roses trémières. Elle se manifeste par l’apparition de petites taches jaune-orangé puis brunâtres sur le dessous des feuilles, correspondant à des pustules de spores. Les feuilles atteintes finissent par jaunir et se dessécher prématurément. Pour lutter contre la rouille, il est conseillé de supprimer rapidement les premières feuilles tachées et de les détruire. On évitera également d’arroser le feuillage afin de ne pas favoriser la propagation du champignon.
- Oïdium – Par temps chaud et humide, un feutrage blanc poudreux peut apparaître sur le dessus des feuilles : c’est l’oïdium, ou « blanc », une autre maladie fongique. Bien que moins répandu que la rouille sur cette plante, il peut survenir en été. Un traitement préventif au soufre ou l’application d’un fongicide biologique (par exemple à base de bicarbonate) dès les premiers signes contribue à enrayer l’oïdium. Là encore, éliminer les feuilles gravement touchées aide à préserver le reste de la plante.
- Parasites et ravageurs – Quelques insectes peuvent s’attaquer aux roses trémières. Les pucerons forment parfois des colonies sur les tiges et boutons floraux, ce qui peut affaiblir la plante et déformer les fleurs ; un jet d’eau ou une pulvérisation de savon noir suffit en général à les éliminer. Les jeunes pousses tendres peuvent aussi attirer les limaces et escargots, surtout au printemps : il convient de protéger les semis ou jeunes plants (par des barrières anti-limaces ou en surélevant les pots, par exemple). Enfin, un petit coléoptère spécifique, le charançon de la rose trémière (Apion), peut perforer les boutons floraux et pondre dans les graines en formation, rendant celles-ci non viables. Les dégâts du charançon se remarquent sur les boutons troués qui avortent, mais heureusement son impact sur la floraison globale reste limité.